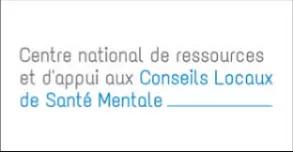Sans être une structure de soins ni une entité juridique, ou un contrat, le CLSM est un espace d’échanges, de coordination et d’actions au service du bien-être psychique des populations, en particulier les plus vulnérables.
Reconnus juridiquement par la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, décrits dans l’instruction du 30 septembre 2016 et inclus dans la Feuille de route santé mentale et psychiatrie 2018, les conseils locaux de santé mentale (CLSM) ont pour objectif principal la définition et la mise en œuvre d’une stratégie locale de santé mentale par les acteurs du territoire.
L’instruction du 13 mai 2025 complète celle de 2016 en proposant un référentiel national qui vise à :
- clarifier la place et le rôle des CLSM dans la planification territoriale en santé, leurs articulations avec d'autres dispositifs de coordination d'acteurs locaux (notamment CLS, PTSM)
- guider les acteurs et les décideurs dans la structuration et la mise en place des CLSM
A l’appui du référentiel, un guide de recommandations, élaboré lui aussi par le Centre national de ressources et d'appuis aux CLSM du Centre Collaborateur de l'OMS fournit des éléments méthodologiques illustrés par des exemples de CLSM sur le terrain.
Un CLSM a pour objectif principal de définir et de mettre en œuvre une stratégie locale de santé mentale, articulée autour de cinq objectifs spécifiques :
- Lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale
- Agir sur les déterminants de la santé mentale
- Prévenir les troubles psychiques
- Favoriser l’inclusion et le respect des droits des personnes concernées par un trouble psychique
- Favoriser des parcours de soins accessibles et adaptés
- Un comité de pilotage, garant de la stratégie territoriale
- Un comité technique, chargé de l’opérationnalisation
- Des groupes de travail thématiques, selon les priorités locales (jeunesse, logement, prévention, etc.)
- Une assemblée plénière, ouverte à l’ensemble des partenaires et citoyens
Évoluant dans un cadre participatif, le CLSM est ainsi un outil de démocratie sanitaire en santé mentale, créé à l’initiative des acteurs locaux, à l’échelle d’une commune, d’une intercommunalité ou d’un arrondissement, en tenant compte des dynamiques et spécificités du territoire.
Sous l'égide du maire ou du président de l’intercommunalité, il rassemble tous les acteurs locaux, dont la psychiatrie publique et les personnes concernées par les troubles psychiques et leur entourage, pour agir de manière concertée sur les déterminants de la santé mentale, au bénéfice des habitants du territoire.
Chaque CLSM s’organise autour de plusieurs instances :
Cette structuration favorise l’agilité, la co-construction et l’ancrage territorial des actions menées.
À la suite des constats alarmants faisant état des besoins en santé mentale, la loi du 21 février
2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique dite « 3DS » prévoit que les CLS intègrent un volet santé mentale qui peut être mis en œuvre via un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).
Un CLSM sur le territoire permet de renforcer l’impact de la stratégie de santé mentale, en offrant une approche spécialisée et adaptée qui complète et approfondit les actions du CLS. L’émergence d’un CLSM dans un territoire à forts besoins peut constituer un objectif de CLS.
Les CLSM et les PTSM jouent, chacun à leur niveau, des rôles essentiels et complémentaires dans l’identification des besoins en santé mentale et la mise en place de solutions adaptées aux territoires.
En étant au plus près du terrain, les CLSM permettent aux PTSM de rester en phase avec les réalités locales, tandis que les PTSM offrent aux CLSM un levier pour faire remonter leurs constats et besoins au niveau départemental. Ces deux démarches collectives et collaboratives réunissent divers acteurs pour définir une stratégie cohérente pour le territoire.
La différence principale réside dans leur échelle et leur cadre : les PTSM, déployés au niveau départemental, se concentrent sur six priorités spécifiques, alors que les CLSM, ancrés sur des territoires plus restreints (commune ou intercommunalité), ajustent leurs priorités en fonction des besoins locaux. Ainsi, l’articulation entre les CLSM et les PTSM repose sur des échanges dynamiques et réciproques entre les niveaux local et départemental.