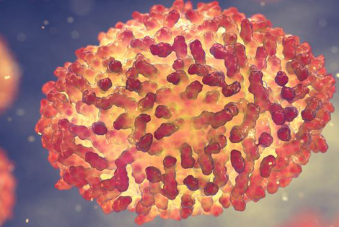Les infections par ce virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire. Ci-dessous un lien pour en savoir plus sur l'évolution de la situation.
A l'approche de l'été, avec le retour des festivités, l'objectif est de réactiver la vigilance vis à vis de cette maladie pour éviter une reprise épidémique. La vaccination est une protection efficace qu'il faut proposer aux personnes à risque. Il faut aussi rappeler les autres gestes de prévention comme le respect de isolement pour les personnes malades qui permet de protéger les autres.
La variole du singe, qu'est-ce que c'est ?
Après une période d’incubation pouvant aller de 5 à 21 jours, les premiers symptômes peuvent se manifester sous la forme de fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et/ou une asthénie (fatigue). La maladie peut également provoquer une augmentation du volume des ganglions situés sous la mâchoire, au niveau du cou et de l’aine. La personne est contagieuse dès l’apparition des premiers symptômes.
Dans les 1 à 3 jours (parfois plus) suivant l’apparition de la fièvre, le patient développe une éruption cutanée sous forme de vésicules remplies de liquide qui évoluent vers le dessèchement, la formation de croutes puis la cicatrisation. L’atteinte cutanée survient en une seule poussée. Des démangeaisons sont fréquentes. Les bulles se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale. Les personnes ne sont plus contagieuses à partir du moment où toutes les croûtes sont tombées. La maladie dure généralement de 2 à 3 semaines.
Comment se transmet ce virus ?
La variole du singe se transmet d’une personne à une autre par contact étroit avec une personne qui présente une éruption cutanée due à la variole du singe, y compris par contacts en face à face, de peau à peau, de bouche à bouche ou de bouche à peau, notamment les contacts sexuels. Elle se transmet également par le partage d’objets ayant été en contact avec cette dernière comme du linge (vêtements, draps, serviettes…), d’ustensile de toilette (brosses à dents, rasoirs…), vaisselle, sextoy, seringue...
Aujourd’hui, le Monkeypox n’est pas considérée comme une infection sexuellement transmissible (IST) mais les rapports sexuels réunissent toutes les conditions pour une contamination. Avoir plusieurs partenaires augmente le risque d’être exposé au virus.
Une personne malade peut contaminer dès l’apparition des symptômes et jusqu’à la cicatrisation des lésions. Tant qu’il n’y a pas de symptôme, il n’y a pas de risque de transmission.
Il est important que les malades respectent un isolement pendant toute la durée de la maladie, jusqu’à disparition des dernières croutes (le plus souvent 3 semaines).
Que faire en cas de symptômes ?
En cas d’apparition de symptômes (éruption cutanée avec des vésicules avec ou sans fièvre), isolez-vous et contactez votre médecin ou appelez le 15.
Le médecin qui vous examinera, procèdera d’abord à l’élimination d’autres maladies à éruption cutanée comme la varicelle, le syndrome pieds-mains-bouche, un zona, la rougeole, les infections bactériennes cutanées, la gale, la syphilis et les réactions cutanées allergiques.
La confirmation du diagnostic de la variole du singe peut nécessiter une analyse biologique notamment par un test PCR. Le prélèvement de préférence est le prélèvement cutané et/ou nasopharyngé si la personne a une poussée éruptive dans la bouche ou la gorge.
Plateforme téléphonique dédiée
Santé publique France lance à partir du mercredi 13 juillet une plateforme téléphonique d’information afin de répondre aux questions du public sur les symptômes, les traitements, la vaccination et d'orienter vers les dispositifs de prise en charge.
Ligne téléphonique gratuite :
Monkeypox Info service : 0801 90 80 69
Accessible 7j/7, de 8h à 23h.
Une vaccination efficace pour les personnes contacts à risque, mais également à titre préventif
Pour les personnes contacts à risque, une vaccination efficace peut être proposée. Elle doit être réalisée dans les 14 jours après le dernier contact avec la personne malade.
La Haute autorité de santé recommande également une vaccination préventive pour les personnes les plus à risque d’exposition. Retrouvez toutes les informations et les lieux de vaccination de Nouvelle-Aquitaine.
Retrouvez tous les lieux de vaccination préventive : La rubrique "vaccination préventive contre le virus monkeypox
Supports d'information Monkeypox
Santé publique France

Santé publique France a créé des supports d'information sur le monkeypox : mode de transmission, symptômes, conduite à tenir en cas d'infection...
Pour plus de supports d'information, un site internet
Un kit d'outils régional pour promouvoir à la vaccination Monkeypox
L'ARS Nouvelle-Aquitaine vous propose en collaboration avec les associations de terrain un kit d'outils pour promouvoir la vaccination Monkeypox. A votre disposition ci-dessous, des vidéos questions/réponses sur le monkeypox et la vaccination ( cliquez droit sur la vidéo puis enregistrer) :
| Où se faire vacciner ? |
Est-ce que c'est grave ? |
Comment se protéger ? |
Combien de doses ? |
|
|
|
|
|
Vous pouvez télécharger en bas de page : une affiche personnalisable et un flyer. La délégation ARS de votre département tient à votre disposition des exemplaires de cartes postales imprimées, n'hésitez pas à la contacter pour venir en récupérer.
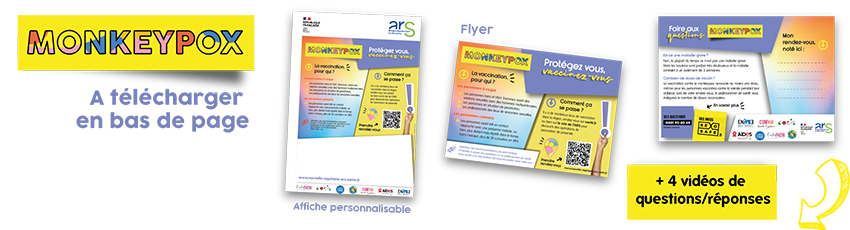
Comment ça se passe pour les prélèvements et les analyses biologiques ?
La confirmation du diagnostic repose sur l’analyse biologique des prélèvements réalisés (résultat positif avec les techniques de qPCR ou RT-PCR spécifique du virus MKP (CNR) ou générique du genre Orthopoxvirus (ESR)).
La liste des laboratoires publics et privés en capacité de réaliser les prélèvements est disponible ci-joint. Il est conseillé de prendre contact par téléphone au préalable.
Les prélèvements réalisés sont ensuite analysés par l’un des 3 laboratoires spécialisés de Nouvelle-Aquitaine (CHU Bordeaux, CHU Poitiers, CHU Limoges).
Des sources d'informations complémentaires importantes
Le site du Ministère, très complet, avec toutes les informations importantes à destination des professionnels de santé :
Les fiches pratiques de la COREB (prise en charge patients, aide au diagnostic dermatologique...) :